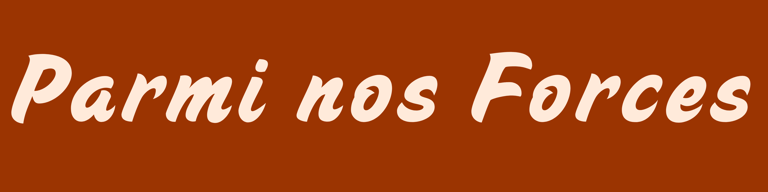Nos colères collectives
Notre capacité à nous indigner, elle aussi, est une ressource. Elle est le signe que nous ne sommes pas résignés, que nous savons encore reconnaître l’inacceptable, que nous sommes à même de...
COLÈRES
5/3/20255 min read


Notre capacité à nous indigner, elle aussi, est une ressource. Elle est le signe que nous ne sommes pas résignés, que nous savons encore reconnaître l’inacceptable, que nous sommes à même de nommer ce qui doit être changé. Ces colères sont des braises sous la cendre. Elles sont des éclats de conscience qui refusent de s’éteindre. Elles naissent là où l’injustice ronge. Longtemps perçues comme un simple débordement émotionnel, elles méritent d’être aussi vues comme une ressource politique, porteuse de potentialités transformatrices.
Les colères collectives émergent généralement face à des injustices perçues, qu’elles soient le résultat d’inégalités économiques croissantes, d’abus de pouvoir ou d’une destruction irréversible de l’environnement. Elles traduisent un refus de la passivité face aux dysfonctionnements, au mépris. Elles se diffusent et peuvent aboutir à des mobilisations durables. Loin d’être une simple réaction émotionnelle, l’indignation est un phénomène social structurant, qui révèle des tensions profondes et participe à la redéfinition des normes et des valeurs collectives.
Cependant, toutes les formes d’indignation ne conduisent pas à des changements positifs. Certaines peuvent être récupérées, instrumentalisées, ou se transformer en ressentiment, nourrissant la polarisation et le rejet de l’autre. C’est pourquoi l’enjeu n’est pas seulement d’exprimer la colère, mais de la traduire en actions collectives porteuses d’alternatives. Ainsi, elles peuvent être à l’origine des révolutions tranquilles et des transformations profondes. Elles rappellent que les sociétés ne sont pas figées et que le changement est toujours possible. Quoi qu’il en soit, on peut considérer que ces colères collectives et les mobilisations auxquelles elles conduisent sont une ressource essentielle pour plusieurs raisons.
Un signal d’alerte sociale
Symptôme de tensions sociales profondes, ces colères expriment des inégalités structurelles ou des vécus invisibilisés (précarité, racisme, domination). Elles permettent, comme on l’a vu autour de mobilisations comme le mouvement de Black Power aux Etats-Unis ou autour du mouvement des Gilets Jaunes, de nommer ce qui ne va pas, ce qui est ressenti, mais rarement pris en compte ou pire, ce qui est réprimé. On perçoit aussi la portée des colères populaires comme signal chez Achille Mbembe dans Sortir de la grande nuit (2010) ou dans Politique de l’inimitié (2016). Il y évoque la façon dont la colère et la révolte émergent lorsque les moyens d'expression traditionnels sont rejetés ou interdits. Il montre que les mouvements de colère qui traversent l’Afrique (révoltes urbaines, jeunesse frustrée, insurrections citoyennes) sont des alertes sur les impasses du colonialisme et de la démocratie néolibérale.
Felwine Sarr, lui, dans Afrotopia (2016), lui, rappelle que les soulèvements populaires sont des révélateurs d’un désir de transformation radicale, pas simplement des "réactions" émotionnelles. Il appelle à écouter ces colères comme des appels à repenser les modèles de développement, de gouvernance, et de rapports au monde. C’est le même regard sur ces colères que l’on perçoit chez le poète dub Linton Kwesi Johnson. Dans son album Bass culture (1980) sur lequel figurait Inglan Is a Bitch, il exprimait la rage des jeunes noirs caribéens de Londres dans les années 70 et 80. Il dépeignait ces colères comme des cris contre les injustices raciales, sociales, policières : elles sont à entendre comme des avertissements politiques. Ainsi, ces colères et les mobilisations auxquelles elles donnent lieu fédèrent des individus autour d’un sentiment partagé d’injustice, d’un mal-être et de la nécessité de l’exprimer. Elle brise les formes de silence, de dépolitisation, de neutralisation du débat public.
Un vecteur de transformation démocratique.
Ces colères populaires sont un langage collectif pour réclamer justice, égalité et avenir. En tant que telles elles ne sont pas à rejeter comme du "désordre", mais plutôt à comprendre comme des appels à proposer d'autres formes de démocratie. Frantz Fanon voit en elles un acte démocratique et particulièrement, dans les contextes coloniaux, là où des voix sont étouffées. Dans Les damnés de la terre, il montre que la colère des opprimés, loin d’être pathologique, est un pas vers la libération et la réappropriation de la souveraineté.
Un levier d’émancipation
Ces colères sont l’expression du refus d’une place imposée, d’un rôle social dévalorisé. C’est ce que l’on retrouve chez de nombreux penseurs du continent africain et de la Caraïbe comme Fanon qui est qui est un penseur de la colère libératrice. Il montre que la violence et la colère des colonisés sont des moyens d’affirmer leur existence et de sortir de l’aliénation. La colère devient un acte fondateur d’émancipation politique et psychologique. Pour lui, la colère est un acte de libération du colonisé, une manifestation d’un sujet qui refuse sa soumission. Il en est de même chez Ayi Kwei Armah dans Two Thousand Seasons (1973). Elle retrace une épopée africaine de révolte contre la trahison, l’esclavage et la colonisation. Là encore, la colère du peuple est une force de retour à soi, de guérison collective, et de réinvention du futur. Comme Walter Rodney dans How Europe Underdeveloped Africa (1972) elle montre que la colère contre la domination économique est un levier d’émancipation autant qu’une force motrice pour la conscience panafricaine et les mouvements révolutionnaires.
Un révélateur de communs oubliés
Ces colères populaires, lorsqu’elles ne sont pas récupérées, réactivent la solidarité, réveillent des liens collectifs effacés par l’individualisme et favorisent la reconstruction de communautés de lutte. C’est ce que l’on retrouve notamment dans les réseaux de soutien mutuel en contexte de crise ainsi que dans des mobilisations écologiques, décoloniales ou antiracistes. À ces occasions ressurgissent des pratiques communautaires niées, notamment autour des savoirs, des récits, des rituels. Cette idée de ressources ravivées est exprimée par Sylvia Wynter dans son article intitulé Unsettling the Coloniality of Being/Power/Truth/Freedom: Towards the Human, After Man, Its Overrepresentation – An Argument (2003) (1). La philosophe jamaïcaine développe sa pensée sur la déshumanisation coloniale et sur la nécessité d'inventer une humanité, plus ouverte sur ceux qui ont été relégués hors de l’humain. Et dans ce texte, elle montre aussi que les révoltes noires ne sont pas seulement des revendications politiques, mais des actes d’imagination anthropologique : elles posent d’autres façons d’être humain. Elles délégitiment le modèle occidental en valorisant des formes d’existence exclues.
Au final, face aux crises contemporaines, colères collectives et indignation demeurent une ressource précieuse : elles empêchent la résignation, questionnent l’ordre établi et ouvrent des espaces de débat. Elles ne sont pas seulement issues d’opposition ou de désespoir, mais plutôt la révélation de liens solidaires, cultures effacées, récits partagés, gestes ancestraux. Elles deviennent ainsi un moment de reconstitution du “nous”, porteur d’une dynamique d’émancipation, mais aussi de réinvention du politique.
Notes
(1) Publié dans The New Centennial Review, vol. 3, no. 3 (2003), pp. 257–337.)