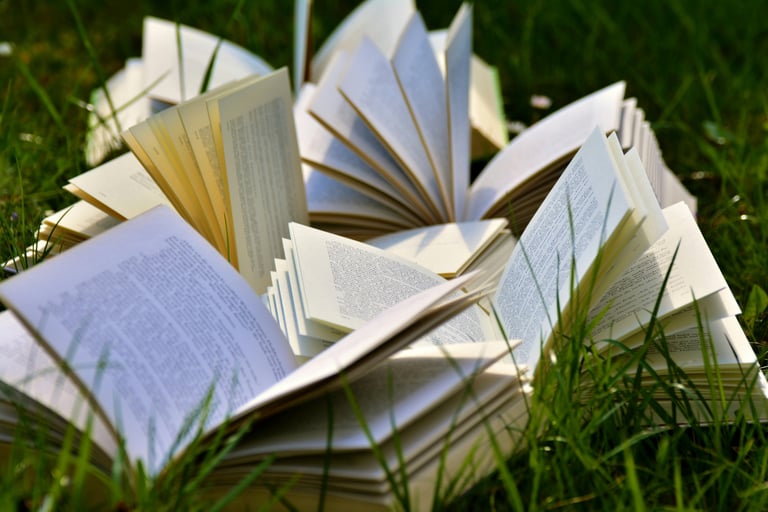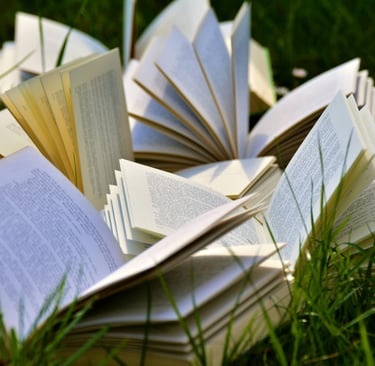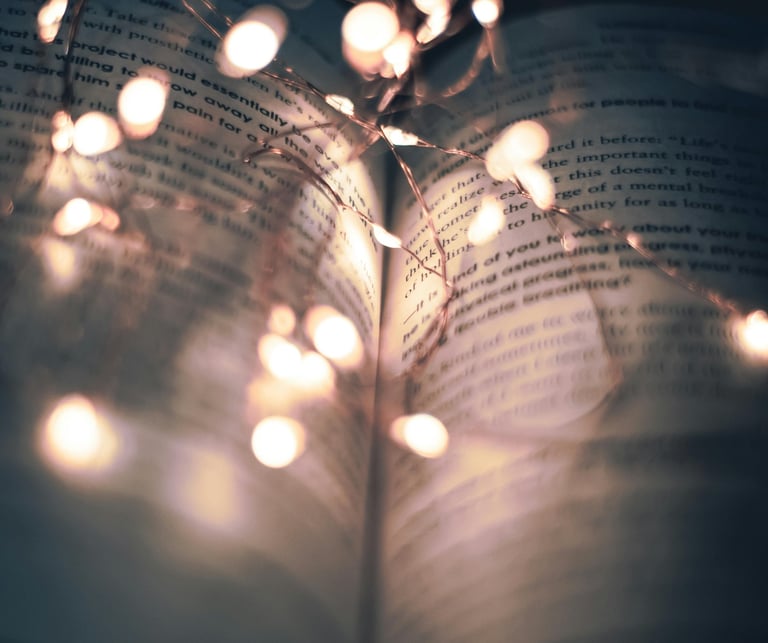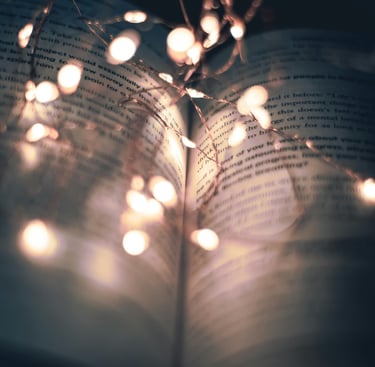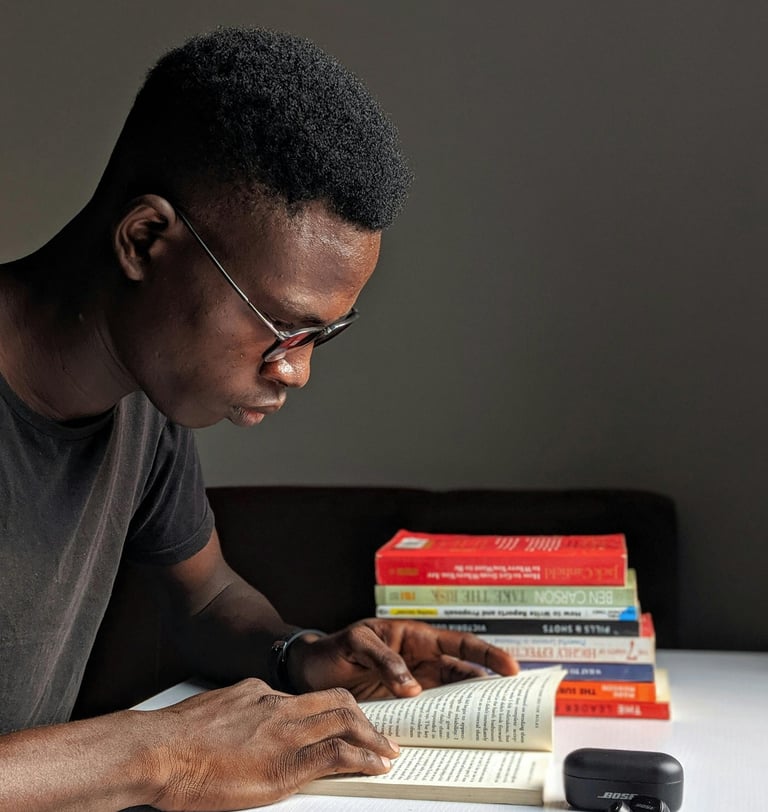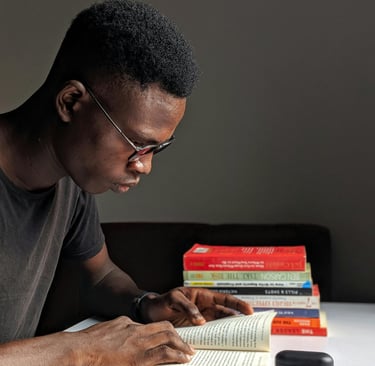Des récits pour construire l’avenir
Dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, les récits, eux aussi, jouent un rôle important. Les crises, souvent accompagnées de fausses informations et de récits alarmistes ou erronés, nous plongent dans l'incertitude. Les récits, fondés sur....
ARTICLE - RÉCIT
9/14/20245 min read
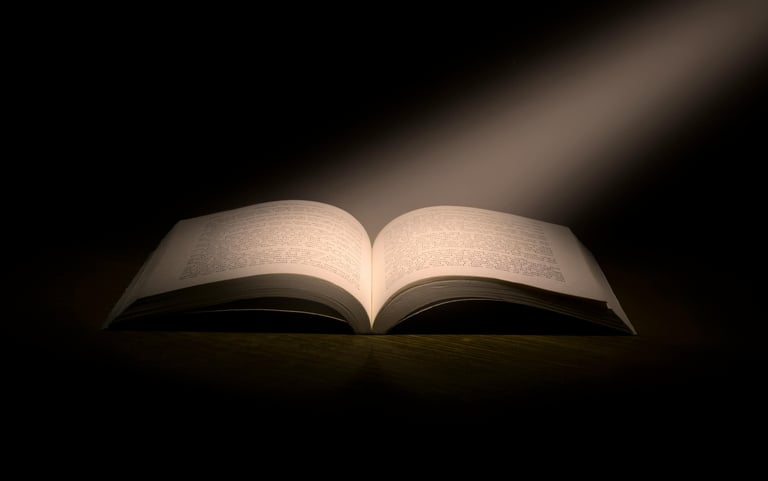
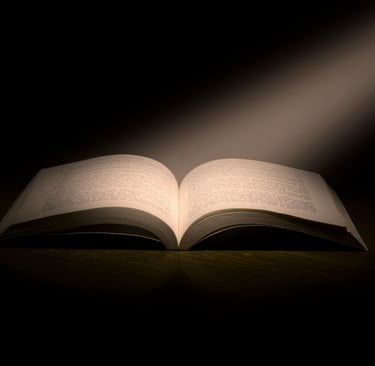
Le récit populaire
Le récit populaire, pour sa part, émane du peuple, c'est-à-dire des communautés, des individus, des traditions orales ou des cultures locales. Il est souvent transmis de manière informelle à travers le folklore, les légendes, les chansons, les contes, ou encore les médias indépendants. Il se transmet souvent de manière orale, à travers des réseaux sociaux informels, des traditions culturelles, ou des médias alternatifs. Sa diffusion peut être locale ou communautaire, mais avec l'essor d'internet et des réseaux sociaux, ces récits peuvent aussi atteindre un public plus large.
Les récits populaires, souvent issus des marges, jouent un rôle clé dans la résistance à l’oppression. Ils permettent à des groupes minoritaires ou marginalisés de se réapproprier leur histoire, de redéfinir leur rôle dans la société et de se battre pour leur reconnaissance.
Les récits populaires peuvent autoriser une multiplicité de vérités, reflétant les réalités variées et parfois contestataires des différentes composantes de la société. Il peut avoir pour but de divertir, d'éduquer, de transmettre des valeurs culturelles ou de critiquer le pouvoir en place. Il reflète les expériences, les croyances et les aspirations des gens ordinaires et peut être un moyen de résistance ou de contestation face aux récits officiels. Il peut être plus flexible, évolutif et capable de s'adapter aux changements sociaux. Il est souvent plus critique, irrévérencieux, ou subversif, remettant en question les récits officiels.
Pour quoi faire?
Leur importance se manifeste à plusieurs niveaux. Ils servent à forger et à consolider l'identité du groupe. Ils racontent l'histoire, les valeurs, les croyances et les aspirations communes, offrant ainsi un cadre de référence qui permet aux membres de se reconnaître entre eux. Ils permettent de transmettre des connaissances, des traditions et des enseignements de génération en génération et renforcent la continuité historique et l’appartenance à un ensemble plus vaste. Par exemple, les récits fondateurs d’une nation créent une continuité historique et justifient les structures de pouvoir en place. En parallèle, les récits populaires peuvent servir de contre-récits, offrant une version alternative de l’histoire, et alimenter des mouvements de contestation ou de revendication.
Les récits, en proposant une vision partagée du passé, du présent et du futur, contribuent à souder les membres d'un groupe autour d'une même expérience collective. Ils offrent des repères et des cadres de sens communs, ce qui est essentiel pour maintenir la cohérence et la solidarité dans des sociétés diversifiées. Ils sont des outils puissants pour définir un groupe, localiser où il se situe dans le monde, et comment il se projette dans l’avenir. Que ces récits soient formalisés et institutionnalisés (officiels) ou qu’ils émanent des communautés elles-mêmes (populaires), ils sont essentiels pour la formation et la pérennité des groupes sociaux et dans les crises contemporaines, les récits constituent des outils puissants se rassembler, et agir.
Conclusion
Au final, les récits ne se limitent pas à une lecture du présent ou du passé, ils permettent aussi d'imaginer des alternatives pour l'avenir. Face aux crises, ils offrent des visions novatrices qui permettent d’envisager des solutions créatives et de nouvelles manières d’organiser la société. A travers les nouvelles perspectives proposées, ils deviennent des outils pour envisager des transformations profondes et trouver des réponses aux enjeux actuels. Ils permettent de donner du sens à l'incertitude et c’est à ce titre qu’ils sont importants et qu’ils sont abordés ici.
Dans le contexte que nous traversons aujourd'hui, les récits, eux aussi, jouent un rôle important. Les crises, souvent accompagnées de fausses informations et de récits alarmistes ou erronés, nous plongent dans l'incertitude. Les récits, fondés sur une compréhension des faits, permettent, eux, de structurer les événements chaotiques, en proposant des explications qui aident à comprendre ce qui se passe et pourquoi cela arrive. Ils donnent une cohérence à la réalité, ce qui a pour effet de renforcer la cohésion sociale. C’est ce que l’on voit quand on s’attarde sur les deux plus connus, à savoir le récit officiel et le récit populaire.
Le récit officiel
Le récit officiel est généralement produit, promu et diffusé par des institutions de pouvoir, telles que les gouvernements, les institutions éducatives, les médias d'État ou les élites politiques et culturelles. Il est diffusé par des canaux institutionnalisés, tels que les programmes scolaires, les médias contrôlés par l'état, les discours politiques, et les cérémonies officielles. Sa diffusion est souvent large et systématique, visant une audience nationale ou internationale. Il est souvent formulé pour représenter une version autorisée ou dominante de la réalité, de l'histoire, ou des événements actuels.
Il a pour objet de légitimer l'autorité en place, de créer une identité nationale unifiée, ou de maintenir l'ordre social, à véhiculer des valeurs, des normes et des idéaux conformes aux intérêts des groupes dominants. soigneusement contrôlé pour présenter une version homogène et simplifiée des événements, en minimisant ou en excluant les contradictions et les voix dissidentes. Il vise généralement à établir une vérité unique, à consolider le pouvoir et défend généralement les perspectives et les intérêts des groupes dominants.
Autres récits
D’autres formes de récits existent en dehors des récits officiels, et des récits populaires. Ils offrent une vision plus nuancée, inclusive et critique de l'histoire et de la réalité sociale. Ils encourage l'utilisation de sources variées et multiformes (orales, écrites, visuelles) provenant de différentes perspectives sociales, culturelles, et géographiques. Ils permettent de construire une compréhension plus complexe et moins centralisée des événements. Ils mettent en avant les témoignages des groupes marginalisés ou opprimés (minorités ethniques, classes sociales défavorisées, femmes, etc.) pour compléter ou contester les récits dominants. On perçoit aussi un récit dans les médias citoyens et les plateformes de publication en ligne. Ceux-ci permettent à un plus grand nombre de personnes de partager leurs propres histoires et points de vue.
Cela peut inclure, par exemple, la reconnaissance des histoires locales ou régionales qui ont été négligées ou des approches qui décolonisent les savoirs, déconstruisent les récits et les connaissances issus des colonisations, et remettent en cause les structures de pouvoir héritées du colonialisme. Cela permet de valoriser les cultures et histoires des peuples et des sociétés non occidentaux, souvent sous-représentés ou déformés dans les récits officiels.